- Accueil
- Publications et statistiques
- Publications
- Part du travail dans la valeur ajoutée :...
Part du travail dans la valeur ajoutée : un diagnostic difficile
Billet n°65. Les évolutions du partage de la valeur ajoutée font l’objet de nombreux débats. En France, le diagnostic dépend largement du champ plus ou moins agrégé sur lequel porte l’analyse et il diffère selon les branches, avec depuis la crise une poursuite de la hausse de la part du travail dans les services marchands et un repli à la baisse dans l’industrie.
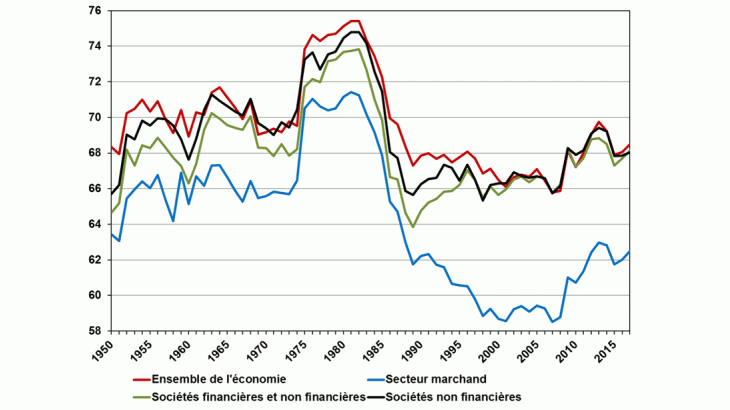
Source : Insee, calculs des auteurs
Le partage de la valeur ajoutée brute (y compris la consommation de capital fixe) entre rémunération du travail et rémunération brute du capital fait l’objet d’une abondante littérature. Un large consensus se dégage pour faire le constat d’une déformation de ce partage au détriment du travail depuis la décennie 1980, dans une grande majorité des pays les plus avancés mais aussi dans un grand nombre de pays émergents (voir par exemple FMI, 2017 ; Chi Dao et al., 2017). La part des revenus du capital étant croissante avec le niveau du revenu des ménages, une telle déformation serait la source d’une augmentation des inégalités de revenus.
Les raisons avancées dans la littérature pour expliquer une déformation du partage du revenu global en faveur du capital sont diverses. Parmi les plus fréquemment évoquées on trouve : i) les effets du progrès technologique et la baisse du prix du capital, à la condition que l’élasticité de substitution entre capital et travail soit supérieure à l’unité (Karabarbounis et Neiman, 2014) ou parce que, dans une logique de "winner takes all", les firmes de l’économie digitale peuvent dégager des rentes importantes (Autor et al. 2017) ; ii) la globalisation, via différents canaux dont un affaiblissement du pouvoir de négociation salariale des travailleurs mis en concurrence (Elsby et al., 2013) ; iii) l’engagement de réformes sur le marchés du travail, qui affaiblit également le pouvoir de négociation des salariés dans le partage de rentes (dans la logique de la modélisation de Blanchard et Giavazzi, 2003, confirmée par Askénazy et al., 2018).
La mobilisation des données sur la France montre que le diagnostic global concernant l’évolution du partage de la valeur ajoutée brute dépend largement du champ plus ou moins agrégé sur lequel l’indicateur est construit (Graphique 1).
On reprend ici l’analyse proposée par Askénazy et al. (2012), avec un partage de la valeur ajoutée mesurée sur données brutes et aux coûts des facteurs de sorte que la part du travail est le complément à 100 de la part du profit, autrement dit du taux de marge. La rémunération du travail comprend ici les salaires, les contributions sociales et les impôts dont l’assiette est la masse salariale. Le profit, ou excédent brut d’exploitation, inclut les revenus du capital (frais financiers et dividendes), l’impôt sur les résultats (IS) et l’épargne brute.
Sur l’ensemble de l’économie, la part du travail baisse d’environ deux points sur les deux décennies 1988-2008 puis augmente de près de quatre points dans la crise avant de baisser d’environ deux points sur les années récentes (Graphique 1). Ce champ global contient le PIB non marchand, qui représente plus du quart du total, et dont l’évaluation obéit à des conventions comptables internationales fortes. Sur le champ du seul secteur marchand, les orientations sont qualitativement similaires, même si elles diffèrent légèrement du point de vue quantitatif après 2008 : la baisse de la part du travail sur les années récentes n’est que d’environ un demi-point. Toutefois, le secteur marchand inclut des entrepreneurs individuels, dont le revenu, mixte, comprend un équivalent salarial qui rémunère leur activité et un équivalent profit qui rémunère leur avance en capital. Les calculs précédents de part du travail supposent un équivalent ‘rémunération salariale’ égal, pour chaque non-salarié, à la rémunération moyenne des salariés.
Sur l’ensemble des sociétés, qui dans la comptabilité nationale française ne comprennent pas d’entrepreneurs individuels, l’évolution du partage de la valeur ajoutée est différente : la part du travail augmente d’environ deux points sur 1988-2008, puis de trois points durant la crise avant de baisser à un niveau qui reste supérieur à celui observé avant la crise. Néanmoins, l’évaluation de la valeur ajoutée des sociétés financières repose également sur des conventions comptables internationales influençant l’analyse. Le champ sur lequel la précision statistique est la plus forte et les conventions les plus réduites est celui des seules sociétés non financières (SNF). Ce champ ne couvre cependant qu’environ la moitié du PIB français. De 1988 à 2008, la part du travail dans les SNF a fluctué autour d’un niveau assez stable. Elle augmente ensuite de plus de trois points pour baisser d’un point à partir de 2013 et reste en fin de période supérieure à son niveau d’avant crise. Ces développements concernant la France illustrent bien les difficultés à élaborer un diagnostic global concernant l’évolution du partage de la valeur ajoutée depuis les années 1980.
Hausse dans les services et baisse dans l’industrie depuis 2008
Le diagnostic précédent peut être prolongé par un examen des évolutions dans les principales branches de l’économie. Pour se placer sur un champ proche de celui des SNF-EI, on retient l’industrie manufacturière d’une part et les services marchands d’autre part, dont on exclut les services immobiliers et les services financiers.
Les évolutions apparaissent très contrastées (Graphique 2). Dans les deux branches, la part des rémunérations était en 2008 à un niveau proche de celui des années 1990, avec des fluctuations cycliques sur la période. Cette part a ensuite fortement progressé dans les services marchands, atteignant fin 2017 un plus haut depuis 1985. En revanche, après un pic cyclique en 2010, cette part a fortement baissé dans l’industrie manufacturière pour revenir à un point bas seulement observé au début des années 2000.
Ce constat n’est pas lui-même exempt de critiques méthodologiques, comme le rappelle par exemple l’Insee (2017). Il importerait ainsi d’examiner les conséquences des évolutions de l’emploi non-salarié ou de l’intérim. En outre, un post récent du bloc-notes Eco rappelle le poids croissant de la consommation de capital fixe dans la valeur ajoutée brute des entreprises, composante attribuée ici implicitement à la "rémunération du capital".

Source : Insee, calculs des auteurs
Au sein des services marchands, il est instructif d’examiner les contributions des différentes sous-branches (au niveau 17) en distinguant : (i) un effet de "structure" lié à l’évolution du poids relatif des sous-branches et (ii) l’effet de déformation intra-branche du partage de la valeur ajoutée.
L’augmentation récente du poids des rémunérations dans la valeur ajoutée brute des services marchands est peu liée aux effets de structure. Elle provient essentiellement de celle, très forte, observée au sein de trois branches : commerce, services aux entreprises et information-communication. Soulignons à nouveau que la hausse du poids des rémunérations ne traduit pas nécessairement un pouvoir de négociation accru des salariés : comme l’illustre le cas des télécommunications, il peut s’agir de l’effet de l’augmentation de la concurrence dans le secteur qui réduit le pouvoir de marché des entreprises.
Mise à jour le 10 Avril 2024