- Accueil
- Publications et statistiques
- Publications
- Le seigneuriage
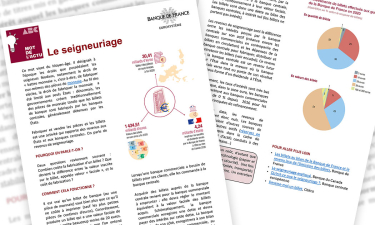
Le mot seigneuriage, à l’époque du Moyen-âge, désignait des droits que possédaient les seigneurs féodaux, notamment celui de fabriquer eux-mêmes des pièces de monnaie. Au fil des siècles ce droit a été limité aux seuls États : désormais, les gouvernements créent traditionnellement des pièces de monnaie tandis que les billets de banque sont fabriqués par les banques centrales, généralement détenues par les États. Trouvez dans cette fiche pédagogique une présentation de 2 pages et 2 infographies pour mieux comprendre ce concept souvent perçu comme abstrait ou complexe.
Le seigneuriage désigne le privilège d'émettre de la monnaie ainsi que de percevoir les revenus qui en découlent. Il désignait au moyen âge les droits que possédaient les seigneurs féodaux de « battre monnaie », c’est-à-dire, de fabriquer eux-mêmes des pièces de monnaie. Au fil des siècles, le droit de fabriquer la monnaie a été limité aux seuls États. Désormais, les gouvernements frappent traditionnellement des pièces de monnaie tandis que les billets de banque sont fabriqués par les banques centrales, le plus souvent détenues par les États.
Fabriquer et vendre les pièces et les billets rapporte des revenus aux États et aux banques centrales grâce au seigneuriage. Le principe repose sur l’écart entre la valeur faciale de la monnaie (le chiffre inscrit sur la pièce ou le billet, par exemple 20 euros) et son coût de production, nettement inférieur. Les revenus de seigneuriage sont la différence entre les intérêts perçus par la banque centrale sur son actif (créance envers les banques commerciales en contrepartie des billets en circulation) et les dépenses de la banque centrale pour fabriquer, distribuer et entretenir les billets.
Comment cela fonctionne ?
Un billet de banque (ou une pièce de monnaie) est adossé à un actif (des prêts aux banques de la banque centrale) dont la rentabilité est supérieure à ce qu’il coûte à fabriquer. Produire un billet a en effet un coût, d’autant qu’il s’agit d’un objet de haute technologie (papier et encres spéciales, signes de sécurité ).
Lorsqu’une banque commerciale a besoin de billets pour ses clients, elle les obtient auprès de la banque centrale en échange d’une dette correspondant à la valeur faciale de ces billets. Sur le plan comptable, la banque commerciale inscrit donc un passif (sa dette envers la banque centrale) et reçoit, en contrepartie, un actif sous forme de dépôts, qu’elle convertit en billets. Lorsque l’un de ses clients retire de l’argent à un distributeur automatique, par exemple 20 euros, la banque diminue simultanément le solde du compte de ce client de 20 euros et réduit son stock de billets disponibles de ce même montant. Pour le client, il s’agit simplement d’une opération de retrait, mais pour la banque, cela se traduit par une diminution de sa trésorerie en espèces et une baisse de la valeur inscrite au crédit du compte du client. Pendant tout le temps où ces billets restent en circulation, la banque commerciale continue d’honorer sa dette envers la banque centrale, généralement sous forme d’intérêts à verser.
Quant à la banque centrale, elle comptabilise le montant prêté à la banque commerciale à son actif, portant intérêt, et la valeur des billets en circulation, qui ne paient pas d’intérêt, est enregistrée à son passif, puisqu’elle doit pouvoir les rembourser s’ils lui sont retournés. C’est précisément cette mécanique, fondée sur l’écart entre le revenu sur le prêt consenti par la BCN à la banque commerciale et le coût de production du billet, qui génère les revenus de seigneuriage.
Mais ces mêmes billets délivrés représentent également une dette de la banque centrale envers le porteur du billet, le billet reste donc au passif du bilan de la banque centrale. Pourquoi ? Parce que ces mêmes billets pourront être rendus ultérieurement, par la banque commerciale à la banque centrale, contre remboursement à leur valeur faciale. Les billets sont donc une dette au bilan des banques centrales, à intérêt nul (les billets ne portent pas intérêt).
Une fois imprimés, les billets sont stockés, transportés et répartis sur tout le territoire. Ainsi, ce revenu de la banque centrale est un revenu futur pour l’État dans la mesure où la banque centrale verse tout ou partie de son résultat net sous forme d’un dividende à l’État et a préalablement versé un impôt sur les bénéfices. Toutefois, contrairement à ce que l’on entend parfois, les banques centrales ne tirent pas la majorité de leurs revenus de la différence entre la valeur faciale et le coût d’impression des billets. Seule une partie des revenus d’une banque centrale provient bien de son activité d’émission de billets, dont l’État lui a confié le monopole La hausse des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) de juillet 2022 à juin 2024 a entraîné une reprise des revenus de seigneuriage, qui étaient nuls lorsque les taux étaient à 0 %. Cette normalisation monétaire visait à stabiliser l’inflation après une période prolongée de taux bas. A noter qu’en plus du seigneuriage, les banques centrales tirent aussi des revenus de leurs réserves en devises et des titres achetés pour soutenir la politique monétaire.
La circulation internationale de l'Euro
Selon les estimations de la BCE, entre 30 % et 50 % des billets en euros (pour une valeur totale de 1 560 milliards en circulation) sont détenus en dehors de la zone euro. Cette circulation internationale de l’euro s’explique notamment par les transferts nets de billets vers l’extérieur opérés par les grandes banques internationales sur le marché des devises.
Toutefois, ces flux n’incluent pas d’autres canaux de sortie de billets, tels que le tourisme, les transferts de fonds des travailleurs migrants ou encore les échanges liés à l’économie informelle (dite « grise »). Le fait que ces billets demeurent souvent hors de la zone euro prolonge leur temps de circulation et réduit la probabilité qu’ils soient restitués à la banque centrale. Cela accroît donc la masse totale de billets sur lesquels la banque centrale perçoit indirectement des revenus de seigneuriage, puisqu’ils figurent à son passif comme une dette à taux nul. En d’autres termes, plus la demande internationale de billets augmente, plus elle contribue à ces revenus, issus de l’écart entre la valeur faciale de la monnaie émise et son coût de production ou de financement.
Quelques chiffres
33,5
milliards d'euros
Valeur des pièces en euros émises à fin 2023
1 567
milliards d'euros
Valeur des billets en euros émises par L'Eurosystème à fin 2023
16,3
milliards d'euros
Impôts sur les sociétés versés par la Banque de France à l'État depuis 2015
15,5
milliards d'euros
Dividendes versés à l'État depuis 2015

Pour aller plus loin
- La Banque de France, premier imprimeur de billets de l’Eurosystème, 2024
- Dessine-moi un billet, Citéco, 2023
- Qu’est-ce que le seigneuriage ?, Banque centrale européenne
- La Banque de France et le financement du Trésor pendant la première guerre mondiale – Ministère de l’Économie et des finances
Télécharger l'intégralité de la publication
Découvrir
L'Éco en Bref
En savoir plusMot de l'actu
En savoir plusVidéos
En savoir plusJeux
En savoir plusAteliers
En savoir plusConcours
En savoir plusL'Éco en Bref
Outils statistique
Mot de l'actu
Outils statistique
Vidéos
Outils statistique
Jeux
Outils statistique
Ateliers
Outils statistique
Concours
Outils statistique
Mise à jour le 7 Avril 2025